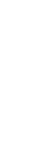
#349 - novembre 2019
Super hérauts
BD et politique
#349 - novembre 2019
Tunisien·ne·s de Belgique
Peu nombreux, peu connus
Contrairement en France, où des enquêtes et recueils de récits ont été réalisés parmi les 600.000 Tunisiens qui y sont installés, il existe très peu de recherches sur la petite communauté tunisienne en Belgique. En 2018, la Belgique compte officiellement 6.200 Tunisiens sur son territoire. Mais selon l’Office des Tunisiens à l’Etranger1 (OTE), près de 24.000 Tunisiens résident ici, contre 28.000 d’après le service consulaire tunisien à Bruxelles. Trois précautions sont à prendre pour interpréter ces écarts. Il faut d’abord savoir que les deux tiers des 28.000 ont la nationalité belge ou celle d’un autre État européen ensuite, la troisième génération, qui garde souvent une distance par rapport au pays d’origine, ne s’inscrit pas d’office au consulat tunisien ; enfin, les personnes sans papiers sont par définition non inclues dans les statistiques officielles. Ce qui explique la fourchette entre les 6.200 résidents ayant uniquement la nationalité tunisienne et les 28.000 Belgo Tunisiens.
La diaspora en chiffres
|
Partir, mais pas trop vite
Ce n’est que depuis son indépendance en 1956 que la Tunisie s’est intégrée aux mouvements migratoires du bassin méditerranéen, bien plus tardivement que le Maroc et l’Algérie où les migrations, en particulier vers la France, remontent aux années 1920. Ce décalage pourrait s’expliquer par une personnalité tunisienne plutôt sédentaire, bien qu’on observe un flux migratoire dès le 19e siècle, principalement vers le Proche-Orient tandis qu’une faible minorité de Tunisiens rejoignaient la France pour s’y former, notamment Bourguiba (président entre 1957 et 1987) qui étudia le droit à Paris dans les années 1920. Notons aussi qu’un an avant l’indépendance, la majorité des juifs tunisiens quittèrent le pays pour Israël ou la France2.
La France des Trente Glorieuses encouragea la main d’œuvre tunisienne, entre autres, à migrer. La Belgique attendra le 7 août 1969 pour conclure un accord bilatéral avec la Tunisie pour l’envoi de travailleurs, sur le modèle des conventions signées plus tôt avec l’Italie (1946), puis l’Espagne (1956), la Turquie et le Maroc (1964). Cet accord de réciprocité généraliste qui traite de la politique de l’emploi et de séjour des travailleurs tunisiens sera complété par plusieurs conventions sectorielles abordant les questions de sécurité sociale, de pension, d’allocations familiales. Selon les chiffres de l’Institut national de statistique (INS), la population tunisienne en Belgique passe de 264 personnes dans les années 1960 à 2.000 au début des années 1970. Sa présence, au départ insignifiante, se renforce ainsi avec l’arrivée de groupes hétérogènes spécifiques : une main-d’oeuvre masculine et des étudiants. S’ajouteront aussi quelques réfugiés politiques de gauche dans les années 1970 et des islamistes à partir de la fin des années 1980, sachant que la plupart préfèreront s’installer en France, en Angleterre ou en, Amérique du Nord, particulièrement au Canada.
Le paradoxe des urbains
Une autre spécificité s’illustre dans la répartition des lieux de départ en Tunisie. Contrairement au cas du Maroc (le Rif au nord) ou de l’Italie (le sud) – historiquement des réservoirs de migrants originaires des régions les moins riches –, les villes côtières réputées les plus prospères de la Tunisie voient partir la majorité de migrants. Citons les gouvernorats de Tunis, Sousse, Sfax, Bizerte, Nabeul, et dans une moindre mesure les régions intérieures. Le paradoxe est là : ce sont les zones les plus urbanisées et les plus développées qui alimentent l’immigration en Europe. Une fois arrivés en Belgique, les Tunisiens se concentrent à
Bruxelles (45 %), Gand, Anvers, Liège, Charleroi. Autrement dit, il y a une correspondance entre une main d’œuvre originaire des grandes villes tunisiennes qui s’installent dans les grandes villes belges. Avec toutefois une particularité : Renaix, petite commune à facilités en Flandre-Orientale, connue pour son industrie textile.
Dispersés dans les villes
Alors que d’autres communautés migrantes ont tendance à se concentrer, la logique de dispersion apparaît comme une caractéristique supplémentaire de l’installation des Tunisiens en Belgique. Par exemple, en Région bruxelloise, ils se répartissent, par ordre décroissant d’importance numérique, entre Bruxelles-Ville, Ixelles, Saint-Gilles, Schaarbeek et Etterbeek. Leur dispersion s’explique par leurs parcours hétérogènes (de l’ouvrier à l’étudiant), et par le fait qu’il s’agit souvent d’une immigration individuelle – le passage par des bureaux de recrutement en Tunisie n’ayant pas été une tendance lourde. Cependant, cette individualité qui pousse à la dispersion ne veut pas dire qu’il n’existe pas de liens communautaires.
Deux autres éléments caractérisent la diaspora tunisienne : leur niveau de formation et la féminisation de l’immigration. L’enquête de l’OTE indique que, en 2005, 39 % des Tunisiens en Europe ont terminé l’enseignement secondaire supérieur du niveau du bac français, et 14,7 % détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur.
Quant à la féminisation de l’immigration, elle est marquée en Belgique par deux moments. Le premier concerne le regroupement familial, a fortiori depuis l’arrêt formel de l’immigration des travailleurs en 1974. Le deuxième moment s’observe dans les années 1990 avec une immigration de plus en plus féminine et fortement scolarisée.
Conciliation pour ne perdre d’aucun côté
Sans que ce ne soit toujours facile, la première génération a dû entretenir le lien avec le pays et une certaine tradition, s’intégrant dans un même temps au pays d’accueil. En prenant l’exemple des fêtes, la première génération nous montre qu’elle organisait les fêtes musulmanes tout en participant à Saint-Nicolas et Noël, dans l’idée que les enfants ne soient pas exclus de l’espace collectif social. Ils ont ainsi établi une forme d’existence à géométrie variable avec leur histoire en Tunisie et leur appartenance à la Belgique. En termes de transmission, on retrouve cette ambivalence ou ce va-et-vient difficile à gérer entre l’ici et le là-bas. Notamment pour la question du mariage des enfants qui les travaille, avec un mélange de respect de la tradition, et d’ouverture d’esprit où certains seront même prêts à remettre en question leurs convictions et valeurs sur le mariage endogame. Cette ouverture est peut-être liée à l’histoire de la Tunisie elle-même où la conception rigoriste de la tradition, et particulièrement des dogmes religieux, ne s’est jamais imposée.
Un amour détaché
La deuxième génération est nourrie à la fois de son histoire d’ici, et d’un attachement-détachement par rapport au pays des parents, tantôt avec nostalgie et amour, tantôt avec un détachement presque définitif parce que ce pays ne leur correspond pas. Quand ils évoquent la Tunisie, en réalité ils parlent du cercle familial avec qui ils sont en contact quasi quotidien. Ils voient les cousins grandir, les neveux naître à un rythme serré que n’a pas connu la première génération, faute de réseaux sociaux. Mais quand ils partent l’été dans leur famille, ils sont contents de revenir chez eux, surtout si les Tunisiens leur signifient qu’ils sont différents d’eux.
La question de la transmission de cette deuxième génération vers la troisième s’inscrit dans cette même ambivalence portée par la première génération, à la différence que les vécus ne sont pas les mêmes. L’intégration de la première génération a reposé sur deux éléments : le travail et le parcours scolaire des enfants comme tremplin social pour trouver leur place dans la société. Quant aux enfants nés ici, socialisés ici, qui considèrent que la Belgique est leur pays, ils restent en quête de reconnaissance, notamment lors de leur parcours scolaire – malgré les vexations, l’exclusion, voire le racisme institutionnel. Outre cette reconnaissance, ils expriment aussi leur souci d’être différenciés : ils sont d’origine tunisienne, et pas marocaine ou autre. Ce souci fait partie d’une dynamique particulière : en tant que Maghrébins, ils se solidarisent à la communauté marocaine, mais s’en détachent en même temps en reproduisant le stigmate contre cette même communauté.
Participation et mosaïque associative
La participation citoyenne des deuxième et troisième générations apparaît comme une autre différence par rapport au vécu de leurs parents, bien que certains de ceux-ci se soient tôt engagés dans des syndicats ou, pour les plus politisés, dans la défense des droits de l’homme en Tunisie. Leurs enfants s’inscrivent davantage dans l’action collective de lutte contre les discriminations, sur les questions de genre, et s’impliquent même dans la politique.
Avant la révolution tunisienne de janvier 2011, la Belgique compte peu associations. Parmi elles, nous retenons l’Amicale tunisienne sous le contrôle du pouvoir de Bourguiba puis de Ben Ali, ou quelques associations éphémères de cadres et de commerçants, toutes ethniques et homogènes. Parmi les associations non gouvernementales opposées au pouvoir de l’époque, on peut épingler dès la fin des années 1960 le syndicat des étudiants UGET très présent dans les universités de Liège et de Bruxelles ; également des associations d’obédience islamistes dans les années 1980, étant donné que le directeur (tunisien) de la Mosquée du Cinquantenaire à Bruxelles recrutait des professeurs de religion islamique dans la communauté étudiante tunisienne en Belgique. Les années 1990 voient se multiplier les débats sur l’interculturel et la laïcité avec, dans la foulée, des associations créées par des Tunisiens: le Centre laïque arabo-musulman (CLAM) ou encore Espace arabesque. Enfin, la particularité individuelle que nous avons évoquée plus haut s’illustre aussi ici puisque beaucoup de Tunisiens et surtout des anciens étudiants se sont intégrés dans des associations de la société civile belge, par exemple via les syndicats.
Après la révolution tunisienne de 2011, nous assistons ici à une effervescence soudaine : une vingtaine d’associations sont créées, dont certaines maintenant disparues. L’Amicale et l’UGET en Belgique ayant disparu, il y a un vide à combler. Des initiatives, souvent en lien avec les mouvements islamistes, sont de type humanitaire et visent à aider les pauvres en Tunisie, les enfants en scolarité, etc. D’autres travaillent ici et en Tunisie pour être présents dans les débats de la transition démocratique en organisant des actions politiques, d’éducation permanente, d’information. Citons la CVDT (Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie) ou l’ADTB (Association des Démocrates Tunisiens de Belgique).
[1] Institution créée en 1988 et basée à Tunis. Elle offre des services administratifs, sociaux, éducatifs aux Tunisiens expatriés.
[2] Simon G., “L’émigration tunisienne en 1972”, in Méditerranée, n° 4, 1973.
Mabrouka, 64 ans, Renaix
Originaire de Kairouan, Mabrouka rejoint son mari à Renaix en 1973. Elle commence à travailler à 19 ans comme ouvrière textile. Et sera pensionnée à 58 ans, en 2011.
“Quand je suis arrivée en Belgique, je ne comprenais rien du tout, je savais juste dire oui et non. On n’habitait pas loin de l’usine. Mon mari m’a appris comment y arriver. Nous avons été accueillis par les soeurs catholiques de Renaix. Avant mon arrivée, elles avaient tout préparé pour mon mari: les lits, les draps, le logement, tout. J’ai pensé qu’elles étaient gentilles, trop gentilles. Parce que je n’avais jamais vu ça en Tunisie. Jamais !
J’ai 6 filles et 2 garçons. Je n’ai pas arrêté de travailler. Mais mon mari m’a beaucoup aidé : il nettoyait, mettait la machine en route pour laver le linge. La première année à l’usine était dure parce que je ne comprenais pas le français. Le travail était dur aussi. Tout le temps debout, à courir. C’était la production ! On avait un quart d’heure pour manger et c’est tout. J’ai reçu la médaille d’or de l’Ordre de la couronne et un brevet du roi Albert II !”
Naïma, 31 ans, Liège
Née à Tunis, Naïma y a étudié la littérature française à l’université. Mariée à un Belgo Tunisien, elle arrive en Belgique en 2013 via le regroupement familial.
“Je n’ai jamais eu, même une seconde, l’envie de partir de Tunisie. J’avais terminé mes études universitaires et trouvé un travail stable. Et puis j’ai rencontré Youssef. Il est Liégeois. Il ne pourrait pas vivre en Tunisie parce que, malgré ses origines tunisiennes, il n’a pas du tout la mentalité. C’est donc moi qui suis venue via le regroupement familial – accepté en trois semaines ! Pour les papiers, je n’ai rencontré aucun souci.Par contre, l’équivalence de mes diplômes et la recherche d’un travail représentent le point noir. J’ai fait cinq ans d’études en Tunisie qui ne valent rien ici. Il fallait refaire une formation. Je suis allée au FOREM où, dès qu’on voit une Arabe, on lui propose un boulot d’aide soignante ou de ménagère. J’ai refusé. Puis j’ai pris mon courage à deux mains. On m’a dit de faire la cuisine. J’étais prête à tout recommencer à zéro. J’ai réussi ma première année en cuisine et j’ai été prise dans la réserve de commis de cuisine au CHU. C’est un autre monde, celui du travail à la chaîne, physique, dur, sans horaire stable. Je n’étais plus moi-même.”
Nabiha, 69 ans, Liège
Originaire de Sfax, Nabiha a rejoint son fiancé à Liège en mai 1968. Elle se marie à 19 ans, devient ouvrière à la FN et a 4 enfants.
“J’ai commencé à travailler comme ouvrière à la FN parce qu’il fallait deux salaires pour pouvoir acheter une maison et pour permettre aux enfants de retourner chez eux dans la famille, pendant les vacances. Il fallait qu’ils aient un contact là-bas. C’est important parce qu’on restera toujours des Tunisiens, on restera toujours Arabes, on restera toujours musulmans. Même si les enfants se marient avec des Belges, des Italiens. C’est nous, c’est comme ça.
Mes collègues femmes m’ont parfois ouvert les yeux. Il y a beaucoup de choses que je n’acceptais pas avant, et que j’accepte depuis. Par exemple, avant, j’étais convaincue que mes filles devaient se marier avec des Tunisiens de Sfax. Parce que c’est la tradition. Une de mes filles s’est mariée deux fois avec des Sfaxiens, et elle n’a pas eu de chance. Ça ne marche donc pas forcément… Maintenant, deux nièces se sont mariées avec un Français et un Belge. Je l’ai accepté.”
Chahine, 30 ans, Bruxelles
Né d’un mariage mixte entre un père tunisien et une mère belge, Chahine a accompli des études universitaires. Il a un frère et une sœur. Il est marié à une Belgo Tunisienne comme lui, et père de 2 enfants.
“Mon père ne nous a pas appris l’arabe. Notre rapport à ce pays si lointain et si exotique est donc limité. Parler avec ma famille, c’est compliqué : ma grand-mère ne connait pas le français et mon grand-père barbotait quelques mots. Quand j’étais étudiant, j’ai provoqué gentiment mon père en lui annonçant que je comptais finir mes études puis partir vivre en Tunisie. Il m’a répondu : « Vas-y, tu comprendras pourquoi je suis venu ici ». Mon père, qui a quitté la Tunisie à 16 ans, n’a pas voulu faire une croix sur son pays. Il tient par contre un discours réaliste : la Belgique est notre pays, il nous a éduqués comme Belges, Bruxellois.
Je pense vraiment qu’il ne veut pas nous faire partager une sorte de nostalgie. C’était son choix de venir en Belgique, et nous n’avons pas à hériter de son choix. Je l’ai accepté.”
Fairouz, 24 ans, Gand
Née à Renaix en 1995. Elle termine sa dernière année de master en droit à l’université de Gand.
“À la maison, nous avions souvent eu des discussions sur les réfugiés, le droit des étrangers. Je voulais comprendre. La façon pour moi de contribuer à une justice sociale était d’étudier le droit. Je serai l’avocate des exclus de la société ! Mais après trois années en droit, j’étais désillusionnée, parce que le droit privé dominait et je n’y trouvais pas la même aspiration que dans le droit international.
Ma maman, qui s’était engagée au CD&V, me disait : « Si tu veux changer les choses, c’est seulement via la politique que tu pourras le faire ». Mais je n’avais pas envie de m’affilier à un parti. Je me suis engagée d’autres manières. On a commencé une association d’étudiants qui organisait des débats à la faculté sur l’immigration, par exemple. J’ai aussi décidé d’être observatrice internationale aux élections démocratiques en Tunisie.”