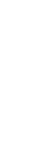
#374 - novembre/décembre 2024
Vert le futur
Ecologie dans les quartiers populaires
#374 - novembre/décembre 2024
Jardins partagés et paliers généreux
Entre mal-logement et spéculation immobilière, Bruxelles palpite aussi au rythme de nouvelles formes de gestion démocratique de son espace. Dans cette dynamique en faveur des solidarités et de la socialisation, quelle est la responsabilité sociale des architectes pour penser et concevoir une cohabitation participative qui dessinerait la ville en un mieux collectif ?Et d’abord, quels sont les exemples inspirants d’un possible dépassement des rapports sociaux dominants ?
C’est dans les brumes scandinaves des années 1960-1970 que l’architecte Jan Gudmand-Høyer (1936-2017), las des dérives individualistes du capitalisme, imagina un modèle d’habitat révolutionnaire1. Son idée? Opposer à l’atomisation sociale la force du collectif, en créant des espaces où la mutualisation des lieux de vie et la participation active des résidents deviendraient le socle d’une nouvelle solidarité. Le “cohousing”, comme on l’appellerait plus tard, repense les rapports entre habitants, repense le privé et le commun, l’individu et le collectif2.
L’architecture, dans cette vision novatrice, n’est plus un simple réceptacle de la vie sociale, mais devient son catalyseur actif. L’architecte imagine alors des dispositifs spatiaux précis: des cuisines communes généreusement dimensionnées, des jardins partagés pensés comme des extensions naturelles des logements, des salles polyvalentes modulables selon les besoins de la communauté. Chaque détail est conçu pour favoriser les rencontres, les échanges, la construction d’une communauté3.
Pendant que le Danemark expérimente des modèles de vie communautaire novateurs, la Belgique des années 1970 voit disparaître ses industries et son passé de métropole coloniale. Bruxelles, devenue une “capitale-laboratoire” d’une modernité bureaucratique, évolue en privilégiant une image internationale et moderne. Les classes populaires, moins intégrées dans cette vision urbaine, sont peu à peu reléguées en périphérie.
S’ouvre ainsi l’ère de la “Bruxellisation”: le patrimoine est sacrifié sur l’autel de la spéculation, tandis que les élites orchestrent la précarisation des masses. La spéculation immobilière, encouragée par les pouvoirs publics, devient le moteur de la transformation urbaine. Les quartiers populaires sont livrés aux appétits des promoteurs, expulsant leurs habitants historiques. Des quartiers entiers sont éventrés, remplacés par des tours de bureaux. La politique et le béton scellent ainsi un pacte où l’urbanisme devient l’arme d’une guerre de classe à peine déguisée4.
La cité devient le théâtre d’une stratégie parfaitement exécutée. D’un côté, on importe une main-d’œuvre bon marché, qu’on parque dans des ghettos délimités. De l’autre, on saborde l’éducation nationale, dernier rempart contre l’exclusion. Dans les écoles des quartiers pauvres, on crée des générations d’enfants parlant un sociolecte qui les enferme davantage dans leur condition, tandis que les élitistes perpétuent la reproduction de classes5.
Bruxelles, consacrée comme siège des institutions atlantistes, voit affluer une nouvelle caste d'”expatriés” aux côtés des “immigrés”. Cette internationalisation accélérée – et célébrée – masque mal les fractures qui se creusent. Et si, jusqu’aux années 1990, le logement reste relativement accessible, le basculement néolibéral va transformer la donne. Les prix vont s’envoler – multipliés par 14 depuis 1973 en termes nominaux, ils quadruplent après correction de l’inflation jusqu’en 2024 – exacerbant les tensions sociales. A partir des années 2000, la gentrification avance comme une marée, repoussant encore une fois les classes populaires et créant une ville à deux vitesses où la mixité sociale et le multiculturalisme tant vanté par Bruxelles ne sont qu’un slogan6.
C’est dans ce contexte qu’émerge, en 2012, le Community Land Trust Brussels (CLTB). Son principe : dissocier la propriété du sol de celle du bâti, afin de sanctuariser des terrains hors de la frénésie spéculative. Le trust conserve la propriété foncière, garantissant ainsi la pérennité de logements abordables, tandis que les habitants deviennent propriétaires de leurs murs.
Le dispositif ne se contente pas d’offrir des logements à prix modérés: il place la participation des habitants au cœur de son fonctionnement. Chaque projet est conçu, développé et géré avec les futurs résidents, dans une logique qui tranche avec un paternalisme habituel de nombreuses politiques sociales. Les espaces communs, généreux et multifonctionnels, favorisent l’émergence d’une communauté solidaire, où l’entraide n’est pas un slogan, aujourd’hui comme à l’époque d’ailleurs.
Mais ne nous leurrons pas: le CLTB, pour vertueux qu’il soit, n’est qu’une étincelle dans la nuit des maux bruxellois. En 2017, un an après les attentats, la capitale se dessine en statistiques terrifiantes: 28 % de sa population croupit sous le seuil de pauvreté. Les quartiers populaires voient le chômage s’abattre sur les jeunes et les femmes d’origine immigrée. À Molenbeek, un jeune sur trois reste sans emploi ; à Saint-Josse, 28 % des femmes cherchent vainement un travail. Le taux d’homicides, avec ses 3,28 pour 100 000 habitants, rivalise encore aujourd’hui avec ceux du Liberia ou de la Moldavie – une statistique qui rend pâle la Suisse ou l’Italie, où l’on enregistre des chiffres sept fois inférieurs7.
Face à cette situation difficile, les discours politiques mettent en avant des principes tels que l’équité et la diversité, mais peinent à répondre aux réalités vécues par une grande partie de la population. Bien que des initiatives comme le Community Land Trust Brussels (CLTB) apportent des solutions encourageantes, elles ne suffisent pas à elles seules. Pour agir efficacement face aux défis du logement et de l’intégration sociale, il est essentiel de repenser en profondeur notre approche : cela pourrait inclure des réformes structurelles, comme l’utilisation de bureaux vacants ou un plan renforcé de construction de logements sociaux. Avec un soutien institutionnel accru et des stratégies orientées vers le long terme, des initiatives comme le CLTB pourraient véritablement contribuer à transformer le tissu social et urbain de Bruxelles.
La cohabitation participative pourrait pourtant, dans l’attente de transformations radicales, offrir une alternative. Non pas comme solution miracle aux maux de la ville, mais comme laboratoire d’une autre façon d’habiter, où la solidarité transcenderait les clivages entretenus par les élites. Les systèmes de propriété partagée, en rompant avec la sacro-sainte propriété spéculative, dessinent les contours d’un possible dépassement des rapports sociaux dominants.
En ce sens, l’architecture elle-même devra être repensée. Plus qu’un simple exercice formel, elle devient dans cette optique un outil politique, façonnant des espaces propices à l’échange et à la résistance collective. Les cours partagées, les jardins et salles communautaires: autant de lieux où peut germer une conscience renouvelée. L’architecte n’est plus le démiurge au service du capital, mais l’artisan de l’espace qui contribue á une transformation sociale.
Malgré des avancées timides, un nombre croissant d’architectes commence à aborder ces questions dans le monde. En Belgique le bureau d’architecture italien Dogma (Piervittorio Aureli et Martino Tattara), travaille depuis longtemps sur ces thématiques. Leur démarche va au-delà des projets et publications: leur exposition récente, New Ways of Living, présentée aux Halles Saint-Géry, a invité le public à repenser la manière dont nous habitons ensemble, questionnant les modes de vie individualistes et la place de la communauté dans l’urbain.
D’autres architectes embrayent sur cette lancée. La chercheuse italienne Marta Malinverni (UCLouvain) est occupée à poser les jalons de l’une des premières recherches doctorales sur ce sujet, et plus récemment, Yassine Belkhayyat-Hassani, co-auteur de cet article, a conclu son parcours académique à l’ULB avec un mémoire consacré à ces problématiques7.
Ces travaux, encore marginaux dans le champ, pointent la nécessité de repenser la production de l’habitat. Ces recherches démontrent que l’architecture participative n’est pas qu’une question de forme ou fonction, mais un outil de transformation. Elles révèlent comment l’organisation spatiale peut soit perpétuer les rapports de domination, soit favoriser l’émergence de nouvelles formes de solidarité.
Force est pourtant de constater que le mal-logement reste le parent pauvre de l’enseignement architectural, symptôme d’une discipline souvent complice des logiques marchandes. Les écoles d’architecture, vassalisées par les intérêts du capital, forment des techniciens dociles plutôt que des penseurs. Les programmes pédagogiques ignorent souvent les questions sociales les plus urgentes. Cette formation au service du marché produit des architectes fréquemment déconnectés des réalités populaires, peu préoccupés par la transformation sociale.
Les centres de recherche, les institutions culturelles, les revues spécialisées : tous détournent pudiquement le regard des questions brûlantes du logement précaire et de l’itinérance, pendant que des millions de manœuvres s’entassent dans des logements insalubres du monde entier. Cette myopie n’est pas innocente : elle reflète la soumission de la discipline aux intérêts dominants, son incapacité à penser une pratique émancipatrice.
Le rôle de l’architecte dans la lutte des classes ne saurait pourtant être négligé. Par son travail sur l’espace, il peut soit renforcer les mécanismes de ségrégation sociale, soit contribuer à créer les conditions spatiales d’une émancipation collective. La cohabitation participative offre ici un terrain d’expérimentation fertile : comment concevoir des espaces qui favorisent la conscience plutôt que l’individualisme? Comment l’architecture peut-elle contribuer à la construction d’une contre-hégémonie?
Les réponses passent entre autres par une réflexion sur les espaces de transition, ces zones tampons entre privé et public où se joue la socialisation. Cours intérieures, paliers généreux, jardins partagés, ateliers collectifs: autant de lieux qui peuvent devenir les creusets de sociabilité. L’organisation spatiale doit favoriser les rencontres, les échanges, la construction d’une solidarité concrète.
La question des matériaux et des techniques n’est pas non plus anodine. Face à l’industrialisation capitaliste du bâtiment, qui standardise et déshumanise, la cohabitation participative peut promouvoir des solutions constructives appropriables par les habitants. L’auto-construction assistée, les chantiers participatifs, l’utilisation de matériaux locaux : autant de moyens de redonner aux classes populaires la maîtrise de leur vie.
Mais ne nous y trompons pas : sans une remise en cause des rapports de propriété et de production, sans une lutte contre la spéculation et l’exploitation, elle risque de rester une expérience marginale. Les initiatives comme le CLTB, aussi vertueuses soient-elles, ne peuvent à elles seules renverser la logique de l’actuel régime des minorités possédantes.
C’est donc à un basculement de la société faut œuvrer, où l’habitat collectif ne serait plus l’exception mais la règle, où la propriété privée du sol céderait la place à une gestion démocratique de l’espace. La cohabitation participative peut constituer un laboratoire de cette transformation, un espace où s’inventent de nouvelles formes de vie, où s’expérimente la possibilité d’une ville post-capitaliste.
Cette expérimentation ne prendra tout son sens que si elle s’articule à un projet plus large de transformation. Les architectes progressistes ont ici un rôle à jouer : non pas comme démiurges imposant leur vision d’en haut, mais comme auxiliaires techniques d’un mouvement populaire d’appropriation de l’urbain. Car c’est dans la lutte collective des exploitées que se dessineront les contours de la ville, une cité libérée de la dictature du profit, où l’habitat ne sera plus marchandise mais droit.
[1] [1] Larsen, H. G. (2019). Three phases of Danish cohousing: tenure and the development of an alternative housing form. Housing Studies, 34(8), 1349–1371.
[2] Iorio, A. (2015). Le cohousing: un nouveau mode d’habiter ? Socio-anthropologie, 32, 87-101.
[3] Ghodsee, K. R. (2023, juin 28). Living communally can make us less lonely. The Nation. https://www.thenation.com/article/society/family-architecture-housing/
[4] Comhaire, G. (2012). Activisme urbain et politiques architecturales à Bruxelles : le tournant générationnel. L’Information géographique, 76(3), 9-23.
[5] Petitat, A. (1999). École et production-reproduction de la société : les théories générales. Production de l’École – Production de la société Analyse socio-historique de quelques moments décisifs de l’évolution scolaire en Occident. (19 -66). Droz. Voyez aussi « Se loger à Bruxelles. Droits dans le mur », in Imag, n° 370, janvier-février 2024, https://www.cbai.be/imag370_janfev-2024/
[6] Van Criekingen, M. (2009). La gentrification comme projet politique global. Espaces et sociétés, 132-133(1), 215-240.
[7] Christian Dessouroux, R., Bensliman, N., Bernard, S., De Laet, F., Demonty, P., Marissal, & Surkyn, J. (2016). Le logement à Bruxelles: diagnostic et enjeux. Brussels Studies, Synopses, (99).
http://journals.openedition.org/brussels/1346
[8] Belkhayyat-Hassani, Y. (2024). La cohabitation participative: un levier pour la réinsertion sociale des migrants à Bruxelles dont cet article est une des premières émanations (Mémoire de fin d’études, sous la direction de G. Carboni-Maestri et A. Morelli). Université Libre de Bruxelles.