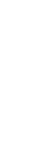
#356 - mars/avril 2021
Mouvances décoloniales
Rébellion des oubliés
#356 - mars/avril 2021
Ceci n’est pas un duel
Une femme, jeune, noire ; un homme, son aîné, blanc. Ils se sont connus en 2018 autour de projets interculturels, et ont accepté pour Imag un échange dynamique sur les principes et stratégies des mouvements décoloniaux, sur le “retour” de la race au nom de l’antiracisme. Qu’est-ce qui se joue ?
Pourriez-vous vous présenter par rapport aux mouvances décoloniales ? En quels termes posez-vous la question de la légitimité de celles et ceux qui parlent aujourd’hui du racisme anti-Noirs ?
Emmanuelle Nsunda: J’ai 30 ans. Je suis militante féministe belge, fondatrice de Afrofeminism in Progress, un mouvement qui explore des questions décoloniales depuis le point de vue des femmes afrodescendantes. Mais pour le moment, je suis surtout programmatrice d’événements culturels. Ma pratique décoloniale, je l’exerce dans ma profession en essayant d’avoir une vision décoloniale à la fois dans la manière de sélectionner les artistes mais aussi de réfléchir aux publics cibles. De plus, je m’investis dans des recherches indépendantes où je m’intéresse à la déontologie et à la pédagogie des arts, et au moyen de décoloniser les pratiques au sein des recherches universitaires.
La voix des personnes concernées par le racisme est essentielle. Historiquement, les luttes antiracistes étaient portées par des structures très blanches qui disposaient des moyens et qui étaient certainement pleines de bonnes intentions1. Il n’empêche que dans la manière dont ces luttes se sont structurées hiérarchiquement, les personnes premières concernées n’étaient pas celles dont la parole était la plus légitime. Ce qui explique aujourd’hui la tendance des personnes noires à vouloir éviter de se retrouver silenciées, et par conséquent à vouloir porter le discours.
Bien que des personnes blanches comprennent cette problématique et soient capables de participer aux déconstructions, un des problèmes dans les luttes antiracistes est la suspicion de subjectivité chez les personnes concernées. Que l’on soit Afrodescendant ou non, il est certain que nous ne sommes jamais neutres. Mais le fait est là : ce sont systématiquement les personnes subissant les oppressions qui sont soupçonnées de ne pas pouvoir amener des analyses cohérentes sur la problématique.
Je terminerais sur la façon dont vous avez posé votre question : en focalisant encore sur les querelles et sur les divisions que la dynamique décoloniale peut entraîner, et pas sur les raisons des crispations. Pourquoi le fait que les Afrodescendants revendiquent le droit à voir leur expertise valorisée au sein des luttes antiracistes provoque-t-il des crispations ? Les personnes crispées se remettent-elles en question par rapport à ce qu’elles ressenten?
Marco Martiniello : Je suis issu d’un quartier populaire de la région liégeoise. J’ai 60 ans et je fais partie de ce que certains appellent la deuxième génération des immigrés. Sociologue et politologue au FRS-FNRS à l’Université de Liège, je travaille depuis près de 40 ans sur les questions liées aux migrations et aux processus d’exclusion et de domination dans la société. Objectivement, je suis blanc. Mais subjectivement, ce n’est pas le point central de mon identité. Je voudrais me référer à James Baldwin – et c’est peut-être de l’appropriation culturelle – lorsqu’il dit dans le documentaire “The Price of the Ticket”: “It’s up to you. As long as you think you are white, there is no hope for you. As long as you think you are white, I’m going to be forced to think I am black”2. Je défends l’idée d’une identité complexe. Ma couleur de peau est un élément objectif que je peux difficilement changer. En revanche, je ne me sens pas du tout participant du même combat que d’autres personnes blanches qui représentent le contraire de mes valeurs, par exemple les suprémacistes blancs et autres racistes. Politiquement, je ne suis pas blanc.
Je me considère comme un sociologue engagé, proche des chercheurs et militants britanniques et américains des années 1960-1970 qui parlaient, à l’époque déjà, de “race and class”; l’approche gender commençait seulement à faire son apparition. Mais déjà, on insistait sur le chevauchement de différents systèmes de domination et d’exclusion.
Je revendique le droit de parler de ces questions de dynamiques sociales, politiques et culturelles, tout en n’ayant pas le droit de parler à la place d’autres. Je n’ai jamais été victime de racisme, si ce n’est des moqueries qu’on appelle aujourd’hui des micro agressions. Bien que je ne peux pas me mettre à la place de celui qui vit ou a vécu le racisme, je peux contribuer à essayer de comprendre les mécanismes du racisme en général – je ne parle jamais de racisme anti-Noirs seul car il me semble vain d’entrer dans le débat, voire une compétition, pour déterminer la forme la plus sévère de racisme. Les outils méthodologiques en science sociale permettent d’essayer de se dégager en partie de son expérience personnelle ou de comprendre et d’expliquer modestement des dynamiques sociales et politiques. Je suis ainsi un chercheur, et non un expert, qui utilise des méthodes pour tenter de comprendre et d’expliquer. Je suis aussi un citoyen ; essayer de comprendre et d’expliquer est un moyen de faire changer les choses.
Pour rebondir sur ce que disait Emmanuelle, il est indéniable que les mouvances décoloniales crispent. Mais il faut voir qui et quand elles crispent. Personnellement, je ne me sens pas crispé par ces mouvements qui mettent le doigt sur des plaies, d’où les réactions de certains qui ne veulent plus ou qui ne voudront jamais qu’on revienne sur le passé colonial, qu’ils soient anciens colons ou leurs descendants directs. Il est vrai qu’une partie de la gauche actuelle peut se raidir aussi sur ce débat, non sur le principe mais sur les modalités.
Emmanuelle Nsunda: Nos discours et actions crispent généralement dans les milieux blancs parce que nous confrontons des personnes qui ne sont pas obligées de se penser en fonction de leur couleur, tout en bénéficiant de leur statut social grâce à leur couleur. Cette soudaine confrontation doit être difficile à accepter pour elles. De là partent les blocages dans les milieux antiracistes investis par une majorité de Blancs qui n’ont jamais pensé à la manière dont ils pouvaient bénéficier de notre oppression. Un conflit est inéluctable entre leurs valeurs morales et ce qu’ils représentent eux-mêmes comme oppression par leur naissance et leur existence, ainsi que par le statut dont ils bénéficient.
Pour revenir à la citation que vous avez faite, je pense que Baldwin ne pointe pas uniquement la couleur de peau mais surtout le statut. Il met ainsi en avant que votre blanchité est invisible et que vous pouvez passer toute votre vie sans en tenir compte. Tandis que moi, chaque niveau de la société me renvoie au fait que je suis une personne noire.
Marco Martiniello: C’est bien pourquoi j’ai parlé d’identité complexe et de ses composantes multiples, ce qui va dans la direction d’une approche intersectionnelle. On ne peut pas en même temps se revendiquer d’une approche intersectionnelle et ne mettre en avant qu’un aspect de l’identité, c’est-à-dire la race, avec ou sans guillemets. Je n’ai ni le pouvoir ni le droit d’imposer l’usage des catégories à quiconque. Nous vivons dans un monde multicolore. Or, le fait de voir le monde uniquement en blanc et noir est réducteur. Que deviennent les Asiatiques, les Roms, les Juifs, …? Il faut aller au-delà d’une homogénéisation des deux groupes. Je trouve que c’est un peu simple de dire que tous les Blancs ont profité et continuent à profiter du système colonial. Les Blancs qui profitaient du système colonial et qui profitent du système postcolonial aujourd’hui sont relativement typés sur un plan économique et culturel. N’oublions pas non plus que, dans la Belgique des années 1950, des espaces publics étaient interdits notamment aux Italiens, perçus comme des gens “pas comme nous”, même s’ils n’étaient pas racisés au sens où on en parle aujourd’hui.
Emmanuelle Nsunda: On peut considérer que les Italiens des années 1950, dominés économiquement, étaient des personnes racisées. Mais ils se sont d’autant plus facilement extirpés de leur catégorie qu’ils sont Blancs. Alors que nous, avec l’historique de domination coloniale basée sur la hiérarchie raciale, nous avons beau changer de catégorie sociale, nous restons toujours assimilés à notre race, tant cet impensé chez les Blancs est difficile à déconstruire.
Autre réaction: je me suis présentée en tant qu’afroféministe mais je me demande à partir de quand on peut estimer que la race prend trop de place dans les luttes intersectionnelles…
Selon vous, qu’apportent les perspectives décoloniales dans les luttes antiracistes?
Emmanuelle Nsunda: Le but des mouvements décoloniaux est de se désolidariser de cette pensée qui voudrait que les rapports de domination de l’époque coloniale ne se perpétuent plus aujourd’hui. Cette pensée a été assimilée par tous les secteurs de notre société. Si on ne commence pas à la déconstruire, on ne sortira jamais des rapports de domination. Alors que l’antiracisme classique considère la responsabilité individuelle comme prédominante, les décoloniaux mettent en avant la responsabilité systémique qui s’infiltre dans les institutions et dans la manière dont fonctionne notre société. On est obligé de travailler sur les deux plans : individuel et systémique. On ne peut donc pas continuer une lutte antiraciste sans passer par cette dimension plus large.
A propos de ce qu’a dit Marco sur la concurrence entre différentes formes de racisme, je tiens à souligner un point. Au sein des mouvements décoloniaux, il existe bien sûr des groupes qui se forment en lien avec nos trajectoires personnelles et historiques (par exemple des groupes noirs formés à partir de leur identité congolaise), ce qui peut donner l’impression d’écarter les autres personnes qui subissent aussi le racisme. Mais j’observe par ailleurs des alliances qui se développent vis-à-vis d’autres groupes. Autrement dit, mettre en avant des oppressions particulières ne veut pas dire éliminer ou évacuer les autres.
Marco Martiniello: Il existe une grande hétérogénéité dans les mouvements décoloniaux qui sont parfois secoués par des positions divergentes, comme on l’a vu lors de la préparation de la manifestation de Black Lives Matter en juin 2020 à Bruxelles. Qui pouvait parler? Qui pouvait participer? Ces questions se sont posées. Certains militants Belges afrodescendants non congolais ont eu le sentiment que les Congolais voulaient dominer le mouvement à cause de l’histoire particulière qui unit la Belgique et le Congo. Il me semble qu’on devrait revenir davantage aux origines et se rappeler que les perspectives décoloniales proviennent au départ d’Amérique latine3.
On peut être d’accord avec l’idée que la fin officielle des colonies n’a pas signifié la fin du colonialisme car on ne peut pas réduire l’évolution du monde à des ruptures, en oubliant les continuités. Notre société actuelle est liée à l’époque coloniale – on peut même remonter jusqu’à la traite4 et plus haut encore dans le temps. Ces liens ne signifient pas que tout se perpétue comme tel, mais il n’y a rien à faire : ces liens marquent les esprits! Et sur ce point, beaucoup de Blancs progressistes sont parfois en difficulté parce qu’ils pensent à tort que les Blancs ont tous libéré leur esprit des conceptions racistes et racialistes. Le travail de déconstruction est compliqué et il n’est pas toujours mené de manière efficace.
Cela dit, il est dommage que les Belges lambda perçoivent le décolonialisme juste comme la lutte de jeunes visant à abattre des statues ou à changer le nom de rues. Ce qui pose la question de la pédagogie et de l’explication. La pensée décoloniale est une tentative de mise en action stratégique d’une analyse du racisme structurel. Quant aux stratégies concrètes à suivre, on pourrait débattre…
Emmanuelle Nsunda: Concernant la question de la pédagogie, nous tendons la perche à celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la pensée décoloniale: des militants produisent tellement d’analyses et de formations accessibles et variées, et d’autres n’hésitent pas à se mettre en danger sur les plateaux de télévision pour faire ce travail d’explication! Cela dit, les personnes concernées n’utilisent pas toujours les moyens les plus doux pour se faire entendre. De plus, ils ont le droit de se tromper aussi.
Quoi qu’il en soit, cet effort pour ouvrir le débat n’est pas nouveau. Mais le fait est là: on est victimes des mêmes discriminations que vivaient nos parents. Il y a donc un blocage. Et c’est du côté du dominant qu’il faut se poser la question: à partir de quand est-il prêt à écouter et à opérer une gymnastique mentale pour interroger ses biais, non seulement d’un point de vue intellectuel mais également dans sa pratique au quotidien?
Les approches décoloniales poussent à sortir des discours théoriques. Par exemple, dans mon travail de programmatrice, je vais sélectionner des artistes, parler avec mes collègues ou d’autres programmateurs, avec en arrière-plan ma vision décoloniale, antisexiste et anticlassiste, pour essayer de ne pas reproduire les mêmes schémas. C’est un levier puissant sur le terrain, viable sur le long terme et qui a un impact positif sur notre santé physique et mentale puisqu’on palpe des résultats concrets, ce qui n’est pas le cas lorsqu’on se lance dans des dialogues de sourds avec des personnes incapables de remettre en question leur statut social.
Marco Martiniello: Je suis d’accord avec la fin de votre propos mais moins avec le début concernant les outils pédagogiques. Bien que ces outils existent, les gens n’y ont pas toujours accès. Ils sont plus informés par ce qu’ils entendent à la radio et lisent sur les réseaux sociaux où ils sont confortés dans leurs opinions.
Par ailleurs, l’approche qui joue sur la culpabilité de l’individu blanc, comme le fait aux USA Robin Di Angelo, cause beaucoup de problèmes… Alors, comment organiser le débat ? On ne sera peut-être jamais d’accord parce que les questions ne peuvent trouver de consensus. En revanche, travailler comme vous le faites dans un secteur particulier est beaucoup plus porteur parce que vous pouvez amener des changements directs. Etre prêt à écouter l’autre est une difficulté qui concerne tous les êtres humains, quel que soit son positionnement social, politique, économique. Malgré tout, il est plus utile de garder des liens de dialogue même si on ne voit pas de résultats concrets. Refuser le dialogue est une erreur.
Emmanuelle Nsunda: J’aimerais rebondir à nouveau sur l’accessibilité aux outils pédagogiques. Il existe des tentatives pour faire entrer ces outils dans des canaux d’information plus larges. Or, entrer dans ces canaux est très compliqué pour des personnes racisées. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Le problème est que le système n’accepte pas la pensée décoloniale comme une question de société qui concerne tout le monde, mais au contraire comme un sujet spécifique et à la marge. D’où le frein. Mais grâce aux réseaux sociaux, nous n’avons plus besoin d’attendre la validation des personnes blanches, tant sur la forme que sur le fond, pour déposer et développer notre contenu.
Je suis d’accord avec Marco sur le fait d’entrer en dialogue avec les personnes en désaccord. Cependant, il ne faut pas sous-estimer l’impact que ces échanges impriment sur les personnes directement concernées qui se voient parfois nier leur existence dans ces interactions. Ce ne sont pas des conversations anodines. Je tiens à dire que, dans le cas précis de cette interview, vous êtes deux personnes blanches, certes à l’écoute et en dialogue, mais il existe une certaine violence, même si elle n’est pas intentionnelle, ne serait-ce que dans la manière de formuler les questions. C’est pourquoi nous avons besoin de bloquer ce type de configuration pour nous protéger et préserver notre énergie et notre temps.
Marco Martiniello: Les espaces protégés ne me posent aucun problème pour autant qu’ils n’empêchent pas la rencontre et le dialogue dans d’autres espaces.
Emmanuelle Nsunda: Je ne parle pas que des safe spaces. Quand on se retrouve à ne plus vouloir s’entourer que des personnes noires dans un cercle intime, ça n’a rien à voir avec une volonté d’écarter de manière définitive toutes les personnes blanches de notre vie. Mais c’est une stratégie mise en place pour pouvoir récupérer du temps et de l’énergie.
Pour ne pas conclure, comment continuer à dialoguer et à faire société?
Marco Martiniello: On n’a pas le choix, on doit essayer d’avancer ensemble. Dialoguer ne veut pas dire être d’accord. Il faut essayer de trouver des solutions où l’on ne va pas vers des affrontements, en maintenant le dialogue avec les personnes avec qui on est en profond désaccord. Emmanuelle a ses espaces de dialogue, j’ai les miens. En ce moment précis, nos espaces se croisent pour mon enrichissement. Essayer de faire bouger les choses là où on est me semble une bonne voie, tout en continuant à prendre conscience de la complexification croissante de ce monde.
Emmanuelle Nsunda: Nous faisons déjà société! Les pensées particularistes qui se développent participent à faire société parce que nos débats permettent à certains groupes d’exister et à ceux qui ne sont pas victimes de racisme de bénéficier des changements que nous voulons. La tendance universaliste ne permet pas ce débat vu que c’est le dominant qui décide de l’universel. Faire société, c’est exister dans nos différentes identités, toutes valables autant qu’elles sont.
[1] Pour un bref historique de 75 ans d’antiracismes en Belgique, voyez l’Imag n° 354, décembre 2020, “Antiracismes : comment faire front commun”.
[2] “C’est à vous de voir. Tant que vous pensez que vous êtes Blanc, il n’y a aucun espoir pour vous. Tant que vous pensez que vous êtes Blanc, je vais être forcé de penser que je suis Noir.”
[3] A ce propos, lisez “Le tournant décolonial dans la pensée latino-américaine”, de Luis Martínez Andrade.
[4] A ce propos, lisez l’interview de Catherine Coquery-Vidrovitch, “La traite a engendré le racisme et non le contraire”.
Personne racialisée ou racisée
Formulée en 1972 sous la plume de la sociologue française Colette Guillaumin, la notion de “racisé” est, à l’origine, utilisée en sciences sociales pour étudier le racisme comme construction sociale. Une personne “racisée” désigne un individu susceptible d’être assigné à un groupe minoritaire, et d’être victime de discriminations : dans ce contexte, la race n’est pas considérée comme biologique, mais elle est une construction sociale qui sert à exclure certaines catégories qui subissent le racisme.
Extrait de “Racisé, privilège blanc, intersectionnalité: le lexique pour comprendre le débat autour des réunions non mixtes”, par Assma Maad, in Le Monde.fr, 31 mars 2021.