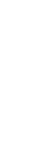
#372 - mai/juin 2024
Evras : les dessous d’une panique morale
#372 - mai/juin 2024
A quel point est-on normatif ?
Psychologue systémique et formatrice sur les questions des minorités, Myriam Monheim aborde le rapport au corps et à la sexualité, et la construction des stéréotypes dans la sexualité des personnes racisées et LGBTQIA+. Avec une question transversale: comment les opposants à l’Evras instrumentalisent-ils ces thèmes ? Démarrons par… un arrêt obligé sur des mots qui prêtent à confusion : qu’est-ce que le sexe, le genre, l’orientation sexuelle ?
Myriam Monheim : La confusion entre ces termes participe en effet à renforcer des stéréotypes et dessert des minorités, en particulier les femmes (en tant que minorité sociale), les personnes racisées et LGBTQIA+. Ces différents concepts de base que sont le sexe, le genre et l’orientation sexuelle sont parfois mis au même plan, notamment par des professionnel·les du soin et de l’éducation. D’où l’intérêt de les redéfinir.
La confusion la plus courante s’opère entre le sexe et le genre. On a l’habitude de considérer qu’il existe uniquement deux sexes dans l’espèce humaine : le sexe mâle, et le sexe femelle. Chaque sexe est associé à un corps physique, hormonal et chromosomique, pensé comme distinct. Cependant, il existe aussi une minorité de personnes situées entre ces deux pôles sexuels, ce sont les personnes intersexes. Elles présentent des caractéristiques mâles et femelles à des degrés divers. C’est à la naissance, parfois à la puberté ou quand elles n’arrivent pas à concevoir un enfant qu’on se rend compte que ces personnes ont un corps un peu “créatif ” par rapport aux deux pôles qu’on connaît.
Au-delà de notre corps, nous avons une identité de genre: comment nous sentons-nous être intrinsèquement ? Exprimons-nous ou pas ce que nous ressentons être à l’intérieur de nous – ce qui est notre expression de genre?
Pour la plupart des êtres humains, s’ils ont un corps mâle, ils se sentent être un homme ; si elles ont un corps femelle, elles se sentent être une femme. Ils et elles ont ainsi un corps qui correspond à leur identité de genre. Des gens peuvent toutefois s’écarter de cette norme : les personnes ayant une identité de genre non binaire, ou les personnes transgenres.
Ainsi, les personnes transgenres sont nées dans un corps femelle et se sentant être un homme, ou nées dans un corps mâle et se sentant être une femme. Certaines personnes transgenres s’engagent dans un processus de transition sociale, administrative ou médicale pour se rapprocher le plus de leur genre vécu. La transition peut donc être sociale, en changeant de prénom et de pronom d’usage ; administrative par le changement officiel sur les papiers d’identité. Et enfin, la transition peut être médicale lorsqu’on s’engage dans des soins hormonaux et chirurgicaux. Aucune de ces étapes n’est obligatoire. Il est difficile de pouvoir établir quelle serait la proportion exacte des personnes trans : certaines études établissent qu’elles représentent jusqu’à 2 % de la population.
Quant à elles, les personnes appelées non binaires ne se retrouvent pas dans cette binarité homme-femme. Certaines s’engagent aussi dans une démarche de transition. A nouveau sans aucune obligation.
Et puis, il y a la sexualité où intervient l’orientation sexuelle : vers quel sexe ou quel genre mon désir est-il orienté affectivement et sexuellement ? On parle d’hétérosexualité, de bisexualité ou d’homosexualité, mais aussi de pansexualité (attirance sans considération du sexe biologique), … Le plus souvent, les personnes de genre masculin sont attirées par les personnes de genre féminin et inversement. A nouveau, ici des gens s’écartent de cette norme hétérosexuelle, parce que, par exemple, ils peuvent avoir un corps femelle et se sentir être un homme à l’intérieur. Ou encore, des personnes s’affirment queer parce qu’elles refusent politiquement de s’enfermer dans une manière de concevoir la sexualité pensée dans une norme.
Face à ces réalités qui demandent des nuances, certain·es professionnel·les du soin genrent mal leurs patients ou refusent d’accepter le genre de leurs patient·es, ce qui crée des ratés dans l’alliance thérapeutique. L’histoire des minorités sexuelles est faite de siècles de maltraitance et de mutilations ; il est temps qu’on cesse d’intervenir sur le corps et la sexualité de ces minorités.
Que répondez-vous aux opposant·es de l’Evras qui craignent que déconstruire les stéréotypes de genre conduise à promouvoir la transidentité ?
Myriam Monheim : L’Evras aborde avec les jeunes des questions liées à leur identité, à leur bien-être, à leurs émotions, à la puberté, aux grossesses non désirées, au consentement. Dans l’absolu, pas grand monde ne s’oppose au droit à dire non et à l’importance de promouvoir le consentement. Il n’empêche que, en termes d’éducation, des adultes apprennent aux enfants à se comporter malgré leur non consentement : embrasser un adulte pour le saluer etc. Or, on se rend compte que plus tôt on apprend aux enfants – et notamment aux petites filles – à affirmer un (non) consentement, plus elles seront capables plus tard de refuser des situations de sexualité dont elles n’ont pas envie. Sur ce terrain, les jeunes font d’ailleurs bouger les lignes.
L’Evras aborde aussi avec les enfants les stéréotypes de genre qui les touchent, afin d’essayer de les libérer des stéréotypes souvent enfermant et qui décrètent, par exemple, que les garçons sont obligés d’aimer le foot et que les filles ne doivent pas y jouer. C’est l’occasion de questionner les enfants sur comment ils vivent les stéréotypes de genre, ce qui n’a rien à voir avec le fait de leur suggérer de changer de genre ! Rappelons que les animations d’Evras se font au rythme de seulement 2 fois 50 minutes en primaires, et 2 fois 50 minutes en secondaires !
C’est dans ce contexte que certains adultes craignent que l’Evras amène du contenu trop intrusif pour les enfants et pensent que les animations sur les stéréotypes de genre susciteront des vocations à la transition de genre. C’est faux, évidemment. Par contre, les animateurs et animatrices Evras ne diaboliseront pas les questions sur la transition ou le fait qu’elle existe – une posture dérangeante pour certains parents qui portent un regard inquiet sur ces réalités.
En quoi cette actualité vous rappelle la fabrique de la peur et de l’homophobie à l’époque de l’épidémie du sida ?
Myriam Monheim : Fin des années 1980, des initiatives se sont formalisées pour lutter contre le VIH. On a considéré qu’il fallait informer les adolescent·es sur le sida, les questions de sexualité, y compris sur l’usage du préservatif. Les homosexuels étant un des groupes le plus touché par l’épidémie, on a commencé à oser parler d’homosexualité alors qu’à l’époque le sujet restait très tabou – des homosexuels eux-mêmes freinaient cette ouverture parce qu’ils n’avaient pas envie qu’on associe homosexualité et sida.
Les réactions les plus conservatrices soutenaient que parler d’homosexualité aux jeunes susciterait «une mode» à l’homosexualité.
Actuellement, j’observe des réactions comparables par rapport aux questions transidentitaires. Des gens pensent qu’il existerait un lobby destiné à susciter des vocations de transidentité, notamment via les réseaux sociaux et l’Evras. Dans cette logique quelque peu conspirationniste, on retrouve étonnamment des personnes qu’on ne verrait pas militer ensemble : à la fois des réactionnaires de droite qui n’aiment pas qu’on touche aux normes genrées, et des personnes religieuses – toutes religions confondues. Face à cette mécanique de la peur de l’autre, les tentatives de réponse prendront du temps. Elles passent par la formation, y compris l’usage de concepts définis et bien compris.
La normativité s’applique aussi sur un autre registre : celle de l’hégémonie occidentale qui attend que les LGBTQIA+ assument et revendiquent pleinement leur homosexualité ou leur transidentité. En effet, aux yeux de nombreuses personnes occidentales LGBTQIA+, il y aurait une « bonne » manière de se vivre et des manières considérées arriérées ou pas totalement émancipées. Or, faire son coming-out tout le temps et partout ne fonctionne pas dans toutes les communautés.
Dans ma pratique professionnelle, je suis au contact de personnes à l’intersection de vécus minoritaires en termes de sexualité, d’identité de genre, de culture ou de religion. Toutes n’ont pas envie de risquer de couper les ponts avec leur famille par coming-out trop frontal. Il s’agit alors d’entreprendre un travail de négociation avec soi-même d’abord, puis avec la famille nucléaire et élargie, dans une forme de non-dit qui a des aspects assez pratiques. Tout se joue dans la discrétion au sein de la communauté : tout le monde sait mais personne n’en parle. La manière de gérer ce double point de vue – faire mais ne pas dire – est incomprise dans les communautés blanches LGBTQI+ où l’on pousse les gens à faire leur coming-out. C’est pourtant une façon culturelle de fonctionner sachant qu’aller au désaccord frontal avec sa famille est inconséquent, vu notamment les difficultés d’accès au logement et à l’emploi spécifiques aux personnes immigrées qui ne peuvent se passer de la solidarité de leur communauté d’origine.
Propos recueillis par N. C.