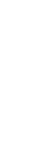
#368 - septembre/octobre 2023
C’est arrivé près de chez nous
LES ATTENTATS – LE PROCÈS – LE CONTRAT SOCIAL
#368 - septembre/octobre 2023
Rendre la société désirable
“Religion”, “radicalisation” et société : arrêtons-nous sur ces mots. Chercher à les définir, c’est montrer à quel point leur sens varie selon nos propres catégories construites. D’où l’intérêt de poser les termes du débat et, par conséquent, les réponses à décliner pour “bien vivre collectivement”.
Quand on se lance dans des études de sciences des religions, la première question qui se pose est celle de la définition de l’objet d’étude. Qu’entend-on par “la religion”? La question peut sembler triviale. Des exemples nous viennent en effet presque immédiatement à l’esprit, comme autant de réflexes quasi pavloviens. “Christianisme”, “judaïsme” et “islam” forment généralement le trio initial (pour ne pas dire primordial) de ce qui constitue une “religion”. Tout ce qui ressemblera plus ou moins à l’un de ces trois modèles sera dès lors considéré comme une “religion”. Cela étant – et c’est ce qui fait tout le sel de la matière – des “cas limites” déstabilisent cette démarche un peu trop confortable.
L’exemple le plus emblématique en la matière est le cas du bouddhisme. Religion ou philosophie? D’aucuns considéreront que le bouddhisme, avec ses moines, ses textes sacrés, ses rites et ses croyances en une forme d’existence après la mort coche suffisamment de cases pour être considéré comme une religion. D’autres feront remarquer que si l’on prend comme paradigme le trio susmentionné, la case la plus importante – à savoir la croyance en une divinité créatrice – n’est pas cochée par le bouddhisme, ce qui doit alors logiquement disqualifier sa nature “religieuse”. Comment trancher entre ces deux positions?
À dire vrai, il n’existe pas de critère qui permet de distinguer avec une objectivité mathématique une “religion” d’une “non religion”: tout dépend de la façon dont un penseur donné va construire sa catégorie. Ainsi, si à la suite de Hegel on définit la religion comme “le lieu où un peuple se donne la définition de ce qu’il tient pour le Vrai”1, on aura tendance à considérer beaucoup d’idéologies comme des “religions qui s’ignorent”. À l’inverse, si on suit la définition de l’anthropologue Melford Spiro pour qui une religion postule nécessairement des “agents méta-humains2” dont le culte et l’existence sont culturellement postulés3, on aura tendance à exclure de la “religion” les idéologies qui ne font pas explicitement référence à ces « agents méta-humains ». C’est la fameuse problématique identifiée par la sociologue Danièle Hervieu-Léger à propos des définitions dites “inclusivistes” et des définitions dites “exclusivistes”4. Avec des définitions très inclusivistes, on peut aller jusqu’à parler de “religion du football”, ce qui ferait bondir un partisan d’une définition plus exclusiviste. Au final, tout a à voir avec la façon dont on construit la catégorie.
En un sens, la problématique n’est pas différente quand on parle de “radicalisation”. Tout comme pour le mot “religion”, ce que l’on intègre dans la “radicalisation” va dépendre directement de la façon dont on définit la catégorie. Certains éminents politologues vont ainsi proposer une définition de la “radicalisation” qui inclut d’office la dimension de la violence5. D’autres, qui parlent plutôt de “radicalité”, n’incluent pas la dimension de la violence dans la définition6. En fonction des définitions de départ, on aura donc tendance à considérer ou non une position ou une action comme “radicale”.
On constate que rien qu’à ce niveau, des questions théoriques fondamentales émergent. Doit-on partir du principe que la radicalisation/radicalité est intrinsèquement liée au passage à la violence, ou peut-on être “radicalisé” sans être violent ? Et qu’entend-on par “violence”? S’il ne fait aucun doute qu’un coup de couteau ou une tentative d’attentat sont des actes de violence physique, on peut se poser la question des formes plus insidieuses comme le refus de l’autonomie des femmes, “justifié” par un discours religieux qui les relègue à la tutelle du mari.
Il est évident que toute mesure de prévention de la radicalisation sera inévitablement influencée par la théorie sous-jacente. La problématique sera doublement complexifiée dans le cas de la radicalisation dite “religieuse” puisque deux catégories (“religion” et “radicalisation”) seront mobilisées. C’est à ce niveau de réflexion que les partis pris ressortent le plus. Les partisans de l’idée selon laquelle la radicalisation dite religieuse n’est religieuse qu’en apparence (la fameuse “islamisation de la radicalité” d’Olivier Roy) auront ainsi tendance à miser sur des mesures de prévention à visée essentiellement psychosociales. Ceux qui au contraire considéreront que la dimension religieuse est centrale dans la radicalisation dite religieuse (la fameuse “radicalisation de l’islam” de Gilles Kepel) axeront les mesures de prévention sur le plan du développement de l’esprit critique, voire d’un contre-discours théologique.
Ces choix peuvent être motivés par des considérations objectives, c’est-à-dire que la favorisation du paradigme d’une “radicalisation de l’islam” ou au contraire d’une “islamisation de la radicalité” sera motivée par des arguments étayés. Mais parfois, la favorisation d’un paradigme sur l’autre peut être davantage motivée par des considérations idéologiques, notamment autour de la stigmatisation d’une tradition religieuse. Dans le cas de l’islam, parler “d’islamisation de la radicalité” permet en quelque sorte de dédouaner la religion qui devient, d’une certaine manière, l’otage d’une violence qui se sert d’elle. On évite ainsi de stigmatiser une communauté de croyants qui, dans leur extrême majorité, condamnent le terrorisme et les processus de radicalisation qui y mènent. Inversement, certains courants politiques, plutôt orientés très à droite, pourront trouver un intérêt à parler de “radicalisation de l’islam” afin de ressusciter un certain ethnocentrisme et appuyer l’idée que la “religion de l’autre” pose problème.
Les diverses asbl et initiatives de lutte contre la radicalisation doivent ainsi composer avec deux défis, quand la radicalisation dite religieuse est en jeu. D’une part, le défi théorique d’une construction solide des catégories de “radicalisation” et de “religion” et, d’autre part, le défi des intrusions de considérations idéologiques dans la façon de poser la problématique.
Dans ce cadre-là, il peut être salutaire de déplacer la focale de l’analyse. Si la “radicalisation” et la “religion” sont des concepts, les individus radicalisés sont des personnes. Le premier geste de prévention peut en ce sens consister à réellement établir un relationnel avec les personnes suivies pour suspicion de radicalisation violente ou dans leur parcours de réinsertion après une condamnation. On peut ainsi prendre conscience, et c’est ce qui semble remonter de plus en plus du terrain, qu’en matière de djihadisme (pour se limiter à cet exemple) les choses ne sauraient se ramener à une “islamisation de la radicalité” ou une “radicalisation de l’islam”. Les histoires individuelles sont toujours complexes, parfois même compliquées. Elles intriquent des affects (souvent douloureux), des réflexions existentielles, des réflexions sociétales, des indignations, des désespoirs, des utopies, des figures d’autorité, des sources de légitimité, des visions du monde et de soi7…
Dans cet enchevêtrement de facteurs et de causes, tous intriqués et jamais indépendants des conditions matérielles objectives et des motivations idéologiques, il peut être difficile pour les asbl et autres structures de prévention de développer des “contre-discours” censés fonctionner sur une gamme large de profils. C’est le fameux problème de la “déradicalisation”. Outre son inélégance à l’oreille, la question de sa possibilité a été posée, y compris par des spécialistes du domaine8. Est-il réaliste d’inverser un processus de radicalisation? De même qu’on ne devient pas radical du jour au lendemain, mais que le processus est incrémental9, peut-on concevoir un processus que l’on pourrait qualifier de “décrémental” et qui permettrait de renouer avec une vision de la société plus apaisée?
À dire vrai, on peut interroger l’idée du “contre-discours” comme stratégie viable. Sur un plan philosophique, on peut considérer que le “contre-discours” est une forme de réponse qui, paradoxalement, entretient la survie de ce que l’on cherche à subvertir. “Répondre” à un discours radical revient en effet à prendre pour point de départ le discours auquel on répond. Pour prendre un exemple concret: contrer les discours violents de figures d’autorité religieuses fondamentalistes en proposant des discours apaisés de figure d’autorité religieuses ouvertes peut sembler une bonne idée. Mais ce faisant, on entretient la source du problème: l’argument d’autorité religieuse qui “fait la pluie et le beau temps”.
Plutôt qu’un contre-discours, ne serait-il pas plus à-propos de proposer une vision renouvelée de la société? Rendre la société désirable pour elle-même et par elle-même? En somme: ne pas lutter contre la radicalisation (et entrer ainsi dans une logique de la réponse), mais bel et bien lutter pour une société dans laquelle se sentir croyant n’entre pas en contradiction avec le fait de se sentir citoyen. Un tel projet se veut peut-être plus ambitieux que le développement de contre-discours. Il ne prend de surcroît pleinement son sens que dans un temps long, ou en tout cas à moyenne échéance. Rendre la société désirable, plus désirable que les promesses des extrêmes, nécessite de repenser ce que “bien faire société” signifie.
À une époque où les identités des uns et des autres tendent à s’entrechoquer, où les revendications s’atomisent pour ne servir que des intérêts de plus en plus particuliers, retrouver un sens du commun devient une nécessité. Sans ce sens du commun, les revendications de “droits” toujours plus individuels finiront par se “décoïncider” des devoirs collectifs. Là réside peut-être les secrets d’une prévention efficace sur le long terme, et accessoirement l’antithèse des projets des extrêmes : recréer un commun collectif qui permette de penser de concert l’individu et la société. En somme: non plus le “soi et les autres”, mais bel et bien le “soi avec les autres”.
[1] Georg W.F Hegel, La raison dans l’histoire, p. 151.
[2] C’est-à-dire, pour faire simple, des êtres surnaturels.
[3] Melford Spiro, “La religion : problème de définition et d’explication”, in Robert E. Bradbury, Clifford Geertz, Melford Spiro, Victor Witter Turner, Edward H. Winter, Essais d’anthropologie religieuse, Paris, Gallimard, 1992.
[4] Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993.
[5] Voir par exemple la définition de Farhad Khosrokhavar dans son ouvrage Radicalisation, Paris, Maison des sciences de l’Homme, 2014, p. 8 : “processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel”.
[6] Voir par exemple la définition du terme donnée par Anne Muxel et Olivier Galland qui ont dirigé l’ouvrage La tentation radicale, Paris, PUF, 2018, p. 9 : “un ensemble d’attitudes ou d’actes marquant la volonté d’une rupture avec le système politique, économique, social et culturel, et plus largement avec les normes et les mœurs en vigueur dans la société”.
[7] A ce propos, lire l’interview de Corinne Torrekens, “La méthodologie de la chercheuse”, en pp. 12-15 de ce numéro
[8] Cf. Elyamine Settoul, Penser la radicalisation djihadiste. Acteurs, théories, mutations, Paris, PUF, 2022, p. 188.
[9] Voir à ce propos les travaux de Gérald Bronner, notamment dans son ouvrage La pensée extrême, Paris, PUF, 2016.